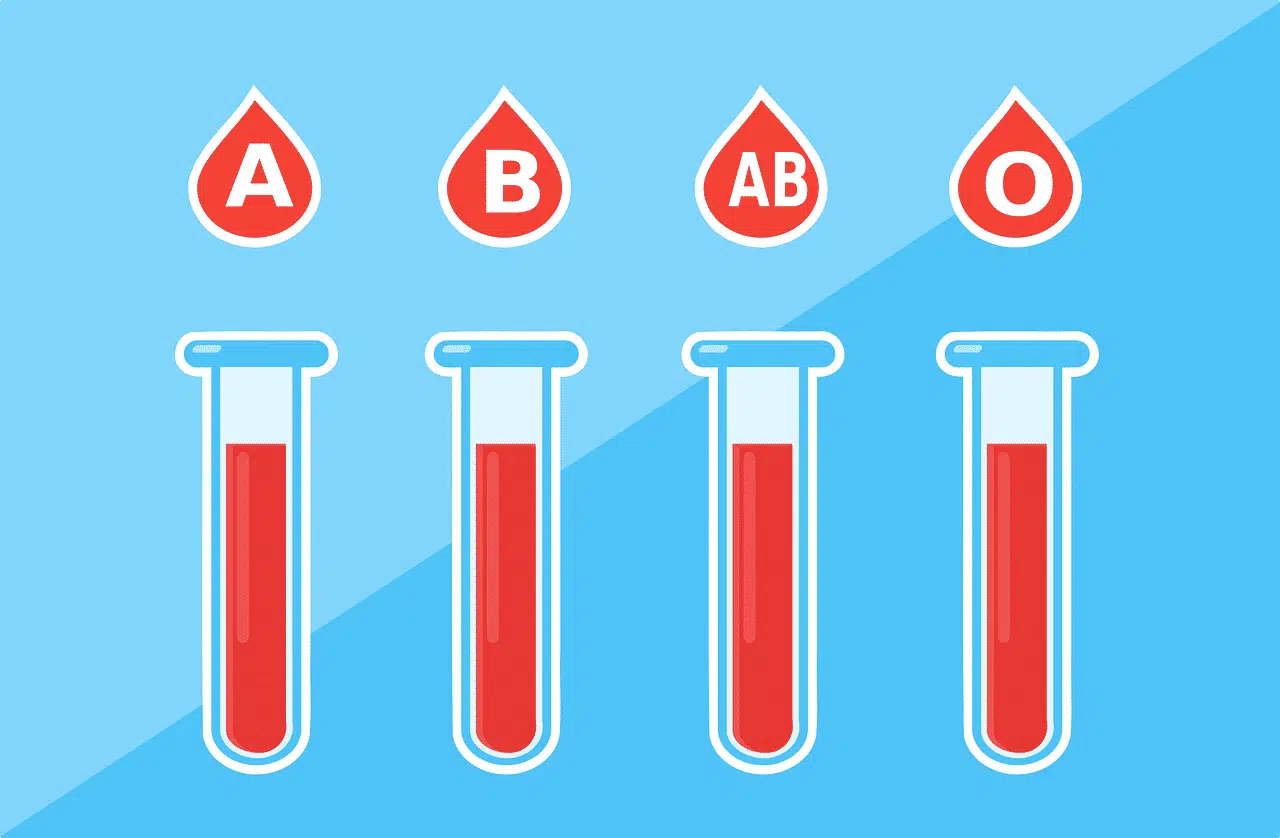Au Zimbabwe, cultiver des légumes en pleine ville n’est ni marginal ni toléré à la marge du droit : la pratique est officiellement reconnue, mais son encadrement reste flou et souvent contradictoire. Les autorités municipales imposent des restrictions strictes, tout en fermant parfois les yeux sur les cultures implantées sur des terrains publics ou privés non constructibles.
L’essor de ces pratiques répond à une pression urbaine, à l’instabilité économique et à l’augmentation du coût de la vie. Les chiffres officiels sous-estiment largement l’étendue du phénomène, alors que des milliers de foyers urbains dépendent de ces cultures pour leur survie quotidienne et leur autonomie alimentaire.
Panorama de l’agriculture urbaine en Afrique de l’Ouest : diversité des pratiques et contextes locaux
L’agriculture urbaine s’est enracinée dans le quotidien de nombreuses métropoles d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique subsaharienne. Dans les artères de Ouagadougou, Dakar ou Cotonou, des jardins vivriers émergent sur les talus routiers, les berges ou les terrains laissés à l’abandon. Les populations urbaines font preuve d’ingéniosité, puisant dans les savoirs paysans pour adapter leurs méthodes à la réalité de la ville.
Les manières de cultiver révèlent une impressionnante diversité. Voici quelques exemples concrets de la pluralité des situations :
- Certains accèdent à des terres communales prêtes à l’emploi, grâce à des initiatives municipales.
- D’autres investissent des espaces vacants, de façon plus spontanée, pour y faire pousser une mosaïque de produits agricoles : légumes-feuilles, tomates, oignons, mais aussi piments, patates douces ou arachides.
Le choix des cultures traditionnelles découle d’une attention portée aux besoins quotidiens et au marché local, tout en intégrant la disponibilité en eau. La production urbaine ne se limite pas à l’autoconsommation. Une partie des récoltes atterrit sur les marchés de quartier, enrichissant l’offre alimentaire et générant des revenus d’appoint.
Au Mozambique ou au Botswana, les dynamiques diffèrent. À Maputo, le maraîchage périurbain structure l’approvisionnement en légumes frais, tandis qu’à Gaborone, la pression sur le foncier freine les initiatives individuelles. Ces évolutions modifient les relations entre populations rurales et urbaines, réinventant les circuits courts et rapprochant ville et campagne.
Quels enjeux pour la sécurité alimentaire et l’économie des villes ouest-africaines ?
La question de la sécurité alimentaire occupe désormais une place centrale dans les grandes villes d’Afrique de l’Ouest. Face à une urbanisation galopante, l’approvisionnement alimentaire devient un défi permanent. Selon la Banque mondiale, près de 40 % de la population urbaine dépend directement de la production vivrière locale ou périurbaine. Cette donnée confirme la montée en puissance de l’agriculture urbaine pour nourrir les citadins.
Un marché urbain dynamique s’organise autour de ces productions. Les aliments issus des jardins contribuent à limiter les flambées de prix et à varier l’offre, notamment lors des périodes de soudure. Pour les foyers les plus vulnérables, ces circuits parallèles offrent une alternative aux filières classiques, souvent imprévisibles ou soumises à la spéculation.
S’ajoute à cette dimension nourricière un impact économique non négligeable. L’agriculture urbaine fait vivre toute une chaîne d’emplois informels, du maraîchage aux marchés de quartier. Les femmes occupent une place décisive dans ce secteur, actrices majeures du dynamisme local.
Les bénéfices de l’agriculture urbaine s’expriment de plusieurs façons :
- Moindre dépendance vis-à-vis des importations alimentaires
- Meilleur accès à des produits alimentaires frais
- Amélioration de la gestion des ressources naturelles locales
Derrière ces avancées, des défis persistent. L’accès à l’eau, la fertilité des sols, la préservation des parcelles cultivables : autant de questions structurantes pour l’avenir du secteur. Les collectivités urbaines commencent à s’impliquer, avec un cadre réglementaire qui tarde toutefois à s’adapter.
Entre traditions et innovations : spécificités de l’agriculture urbaine au Zimbabwe
À Harare, Bulawayo ou Mutare, la population urbaine compose avec un espace agricole en constante évolution. Les flux de migration urbaine redessinent les quartiers, entraînant la multiplication de jardins vivriers sur les marges des zones informelles. Les familles investissent les talus, les rives, les moindres recoins pour cultiver maïs, légumes-feuilles ou patates douces, perpétuant les cultures traditionnelles tout en modifiant leurs méthodes pour s’adapter à l’environnement urbain.
Le droit foncier plane sur chaque parcelle de terre exploitée. Les statuts restent précaires : parfois tolérés, parfois remis en cause par des expulsions ou des autorisations temporaires selon le contexte politique. Les cooperatives d’habitation cherchent à encadrer ces usages, mais la réglementation avance à petits pas. Ce climat pousse les citadins vers l’expérimentation : systèmes d’irrigation bricolés, compost urbain pour fertiliser les sols, associations de cultures pensées pour rentabiliser chaque mètre carré.
L’agriculture urbaine ne se limite plus à l’autoconsommation. Des exploitations commerciales émergent en périphérie, profitant d’un accès plus simple à l’eau et à des terres moins disputées. Ces exploitations, parfois structurées en réseaux, fournissent marchés et supermarchés de la capitale, favorisant une production locale diversifiée et réduisant la pression sur les importations. Entre soutien et contrôle, le gouvernement cherche encore la bonne formule, oscillant entre encouragement et régulation.
Le Zimbabwe face au monde : quelles perspectives pour une agriculture urbaine durable et inclusive ?
Le développement de l’agriculture urbaine au Zimbabwe s’inscrit désormais dans un contexte mondial où les défis alimentaires se croisent à la fois sur le plan local et à l’échelle internationale. La Banque mondiale estime que la dépendance du pays vis-à-vis des importations de produits alimentaires ne cesse d’augmenter, fragilisant la sécurité alimentaire des grandes villes. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) souligne que la production locale reste en deçà des besoins, malgré les initiatives de mise en œuvre de pratiques plus résilientes.
Dans les provinces de Manicaland, Masvingo et Matabeleland, plusieurs projets pilotes émergent : associations de producteurs, accès facilité à la formation, expérimentations en permaculture et agroécologie urbaine. L’objectif ? Atteindre, sinon dépasser, le million de tonnes produites annuellement, sur plusieurs millions d’hectares disponibles en milieu périurbain. La commercialisation des produits agricoles bénéficie aussi du soutien d’un office dédié, qui amorce une structuration professionnelle des filières urbaines.
Si l’Europe et la France en particulier suivent ces évolutions avec attention, c’est surtout pour observer l’émergence de modèles hybrides et adaptatifs. Les partenariats se multiplient autour de l’échange de savoir-faire, de la gestion des ressources naturelles et de la valorisation de produits issus de l’agriculture urbaine. Des entreprises ferment certes leurs portes, conséquence directe des crises économiques récurrentes, mais d’autres misent sur l’innovation et la diversification, portées par une jeunesse urbaine engagée et mobile.
Face à la pression démographique, à la nécessité de sécuriser l’alimentation urbaine et à la course contre les aléas climatiques, le Zimbabwe expérimente sans relâche. Là où des parcelles surgissent sur un terrain vague, c’est tout un pan de la société qui s’invente une nouvelle autonomie.