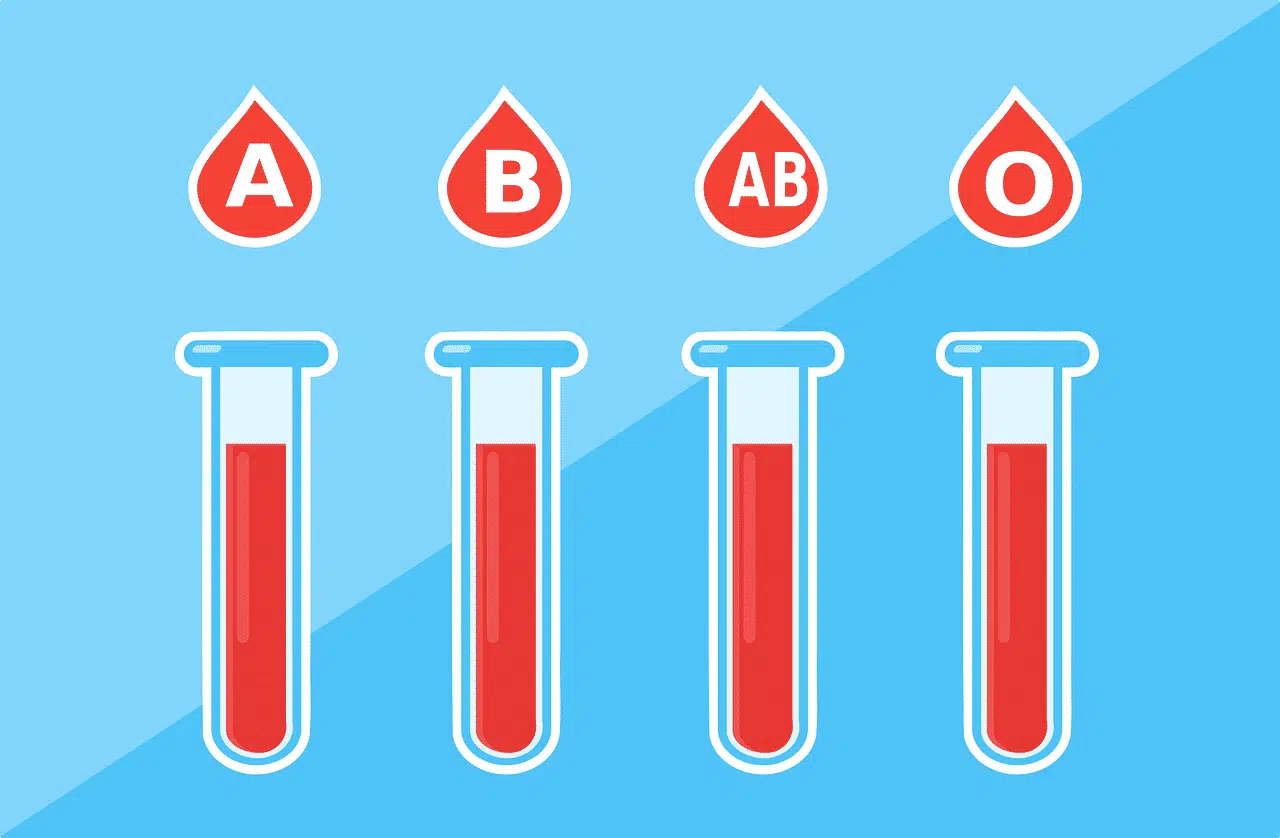La résistance des agents pathogènes à certains traitements progresse plus vite que l’adoption de nouvelles solutions. La rotation des matières actives ne suffit plus à garantir une protection maximale des cultures de blé.
Deux molécules maintiennent pourtant leur efficacité malgré les changements de réglementation et l’évolution des souches fongiques. Leur complémentarité assure une gestion raisonnée des risques sanitaires et économiques.
Comprendre les enjeux des maladies fongiques sur le blé
Impossible d’ignorer l’impact massif des maladies fongiques sur les céréales. Septoriose, rouille brune, fusarium : ces champignons n’attendent pas l’invitation pour s’installer dans les champs, souvent dès l’automne ou au printemps suivant les espèces. La densité des cultures leur facilite la tâche. L’oubli d’un traitement, une surveillance relâchée, et voilà la récolte compromise.
Sans intervention, les pertes de rendement causées par les maladies fongiques peuvent dépasser 30 %. Feuilles tachetées, épis décolorés, grains avortés : autant de signes que la maladie s’installe vite et s’étend encore plus rapidement. Les fongicides ne servent donc pas seulement à limiter la casse, ils sont un pilier de la rentabilité agricole.
Pour mieux comprendre la diversité des menaces, voici les principales maladies à surveiller :
- Rouille brune : tâches orangées sur les feuilles, dissémination rapide grâce au vent.
- Septoriose : nécroses sur le feuillage, progression favorisée par l’humidité constante.
- Fusarium : attaque des épis, production de mycotoxines dangereuses pour la récolte.
Prévenir ces maladies demande une combinaison judicieuse de techniques agronomiques et de recours mesuré aux produits de protection des cultures. Alterner et choisir les matières actives permet de limiter l’apparition de souches résistantes. Quant à la surveillance régulière des champs, elle demeure la meilleure arme pour intervenir au bon moment, avant que la maladie ne compromette la qualité du grain.
Fongicides curatifs et préventifs : quelles différences pour vos cultures ?
Dans le domaine des produits phytosanitaires, il existe une différence fondamentale entre fongicides curatifs et fongicides préventifs. Les premiers, qualifiés de curatifs, sont à utiliser dès l’apparition des symptômes. Leur rôle ? Stopper le champignon déjà présent et limiter la progression des dégâts. Leur force réside souvent dans des matières actives à large spectre, capables de pénétrer les tissus végétaux, un avantage lorsque la maladie se déclare.
Les fongicides préventifs, quant à eux, s’appliquent avant toute apparition de la maladie. Leur objectif : former une barrière protectrice à la surface des feuilles pour empêcher toute installation de pathogènes.
Certains produits, appelés fongicides systémiques, se distinguent par leur capacité à pénétrer la plante et à circuler dans la sève. Résultat : une protection durable, utilisable aussi bien en préventif qu’en curatif. Souvent, ils associent plusieurs matières actives, offrant ainsi une réponse flexible aux imprévus du terrain.
Retrouvez ci-dessous les particularités de chaque type d’action :
- Curatif : agit après l’installation de la maladie, à utiliser dès les premiers symptômes visibles.
- Préventif : s’emploie en amont, bloque toute tentative d’installation du champignon.
- Systémique : offre une protection de l’intérieur, efficace sur la durée.
Le choix du bon fongicide, son mode d’action et le moment de l’application déterminent la réussite du traitement. Pour garder vos cultures en bonne santé, il faut anticiper les risques, ajuster la stratégie selon la météo et surveiller la pression des maladies. Cette vigilance fait toute la différence.
Comment choisir les deux fongicides les plus efficaces pour le blé ?
Le défi consiste à sélectionner une combinaison de produits à la fois adaptée et performante face aux maladies les plus courantes du blé. Pour lutter efficacement contre la septoriose, la rouille brune et la fusariose, privilégiez l’association de familles complémentaires. Un triazole, comme le prothioconazole (utilisé dans Prosaro® ou Maxentis®), pose une base fiable : son large spectre couvre les principaux ennemis du blé, du stade montaison à la floraison.
Pour renforcer l’action, associez ce triazole à un SDHI tel que le fluxapyroxade (présent dans Avastel®). Ce duo limite l’apparition de résistances et assure une protection durable des feuilles et des épis. Le fluxapyroxade a largement fait ses preuves contre la septoriose, même lors d’années à forte pression.
Si votre approche privilégie le biocontrôle ou l’agriculture de conservation, le phosphonate de potassium présent dans PYGMALION® (DE SANGOSSE) s’intègre sans difficulté dans un programme classique. Il offre une sécurité supplémentaire lors des printemps humides.
Pour résumer la pertinence de chaque option, voici les repères clés :
- Triazole (ex. Prosaro®, Maxentis®) : large spectre d’action, efficace contre rouilles et fusarioses.
- SDHI (ex. Avastel®) : ciblage de la septoriose, gestion du risque de résistance renforcée.
- Biocontrôle (ex. PYGMALION®) : complète avantageusement une stratégie de protection selon la conduite du blé.
Ajustez votre choix en fonction de la pression maladie, du développement de la culture et de la météo printanière. Le tandem triazole/SDHI reste une référence solide pour allier efficacité et préservation des solutions de protection.
Stratégies d’application gagnantes pour optimiser la protection de votre champ
Pour préserver durablement vos cultures de blé des maladies fongiques, il est indispensable de diversifier les stratégies et d’ajuster les interventions aux particularités du terrain. La performance d’un fongicide dépend non seulement de son mode d’action et de la famille chimique, mais aussi du respect du stade d’application. Uniformiser les pratiques ne mène qu’à un seul résultat : favoriser l’apparition de résistances. Il faut donc miser sur la complémentarité : alterner triazoles (FRAC 3), SDHI, morpholines (FRAC 5) ou multisites (FRAC M04) permet de contrer les évolutions des pathogènes.
Voici les leviers à activer pour maximiser la protection :
- Alterner les familles chimiques : varier triazole et SDHI reste une méthode éprouvée pour éviter l’adaptation des champignons.
- Traiter au stade le plus pertinent : cibler l’étalement des feuilles du blé, moment où la plante devient la plus vulnérable aux infections.
- Privilégier une utilisation raisonnée : ne pas traiter systématiquement, mais ajuster en fonction de la pression maladie, de la météo et de l’historique de la parcelle.
Les classiques comme la bouillie bordelaise et le soufre gardent leur place, notamment en agriculture biologique ou quand la pression maladie reste faible. Leur mode d’action multisite freine la montée des résistances. Pour les surfaces non agricoles, l’Anti-Dépôt Vert Guard® 2 en 1 illustre la capacité d’innovation : il crée une barrière protectrice tout en éliminant lichens, algues et champignons en un seul passage.
Respecter les doses homologuées est impératif. La qualité de pulvérisation influence directement la répartition du produit sur le feuillage et donc l’efficacité du traitement. Un adjuvant adapté, reposant sur des technologies reconnues (Asorbital, Blue Touch), améliore la couverture et limite les pertes.
Dans la lutte contre les maladies du blé, chaque détail compte. La bonne combinaison de produits, le moment opportun, la vigilance sur le terrain : voilà ce qui fait la différence entre culture fragilisée et récolte maîtrisée. Quand les champignons frappent, mieux vaut avoir pris les devants que courir après les solutions.